En France, Selincro® (molécule active : nalméfène) servait à réduire la consommation d’alcool chez les adultes avec dépendance à risque élevé, en complément d’un accompagnement psychosocial. Pourtant, plusieurs sources rapportent un retrait du marché, provoquant une gêne chez les patients et les professionnels de santé.
Contrairement à un retrait d’urgence ou lié à un danger, ce retrait semble reposer sur des raisons thérapeutiques et réglementaires, notamment l’évaluation des bénéfices médicaux et des conditions d’usage. L’autorité sanitaire a réévalué le service médical rendu (SMR) et souligné un usage parfois hors AMM, provoquant une remise en question de sa disponibilité.
Cet article vous aide à savoir pourquoi Selincro a été retiré du marché. Il décrypte les causes, aborde les risques pour les patients, et propose les alternatives thérapeutiques possibles, tout en expliquant comment accompagner au mieux cette transition médicale.
À retenir
- Le retrait de Selincro repose sur une réévaluation du rapport bénéfice/risque par les autorités de santé.
- Son service médical rendu (SMR) a été jugé modéré, avec un intérêt de santé publique limité.
- Une utilisation fréquente hors indication (hors AMM) a été constatée chez les patients.
- Des alternatives thérapeutiques existent : acamprosate, disulfirame ou naltrexone, selon le profil du patient.

Qu’est-ce que Selincro ?
Selincro® contient le principe actif nalméfène, destiné à réduire les envies de boire chez les patients ayant une consommation d’alcool à risque élevé, sans symptômes physiques de sevrage. L’AMM européenne autorisait ce médicament uniquement pour les adultes respectant ce profil précis. Son action repose sur une modulation des récepteurs opioïdes dans le cerveau, réduisant la motivation à consommer.
Le médicament est prescrit « à la demande », c’est‑à‑dire à la prise anticipée d’un épisode de consommation : une dose par jour maximum, 1 à 2 heures avant. Ce mode d’utilisation s’accompagnait toujours d’un suivi psychosocial, intégré à un plan de gestion des risques (PGR) mis en place par l’ANSM pour assurer un usage approprié.
Pourquoi Selincro a-t-il été retiré du marché ?
Avant de présenter les raisons précises, une courte transition : l’évaluation des usages réels et de la balance bénéfice/risque a conduit à un retrait progressif de la commercialisation. Trois causes principales se détachent.
Réévaluation du service médical rendu (SMR) modéré
Lors de la réévaluation en 2021, la Commission de la Transparence a jugé que le SMR de Selincro restait modéré, avec un intérêt de santé publique limité, malgré une indication ciblée.
L’efficacité observée dans les études cliniques et post-inscription (étude USE‑PACT) était jugée faible à modérée, sans impact majeur sur la morbidité à long terme.
Usage hors indication (hors AMM)
L’étude observationnelle française a montré que près de la moitié des patients traités dépassaient ou ne respectaient pas les critères définis par l’AMM, comme des consommations en dessous du seuil WHO (>60 g/jour pour hommes, >40 g/jour pour femmes).
Cet usage excessif ou inapproprié a rendu le suivi difficile et peu conforme aux recommandations officielles.
Bénéfice limité face à des alternatives déjà établies
Face à d’autres médicaments utilisés dans la dépendance : acamprosate, disulfirame ou naltrexone, Selincro n’apportait qu’une légère amélioration de la prise en charge.
Sa tolérance parfois complexe (risque de dissociation) et les exigences de suivi psychosocial rendaient son rapport coût/efficacité moins favorable dans la pratique clinique standard.
Découvrez aussi pourquoi Stediril a-t-il été retiré du marché ?
Y a-t-il des risques pour les patients qui utilisaient Selincro ?
Le retrait ne semble pas lié à un signal de pharmacovigilance grave, contrairement à un rappel d’urgence. Aucun incident sanitaire imminent n’a été signalé par les agences. Toutefois, l’arrêt doit se faire en concertation avec un professionnel de santé, afin d’éviter une interruption brutale pouvant entraîner une reprise de consommation.
La continuité du traitement était cruciale pour maintenir les progrès. Les patients doivent bénéficier d’un accompagnement thérapeutique personnalisé, notamment si la prescription était hors cadre ou prolongée.
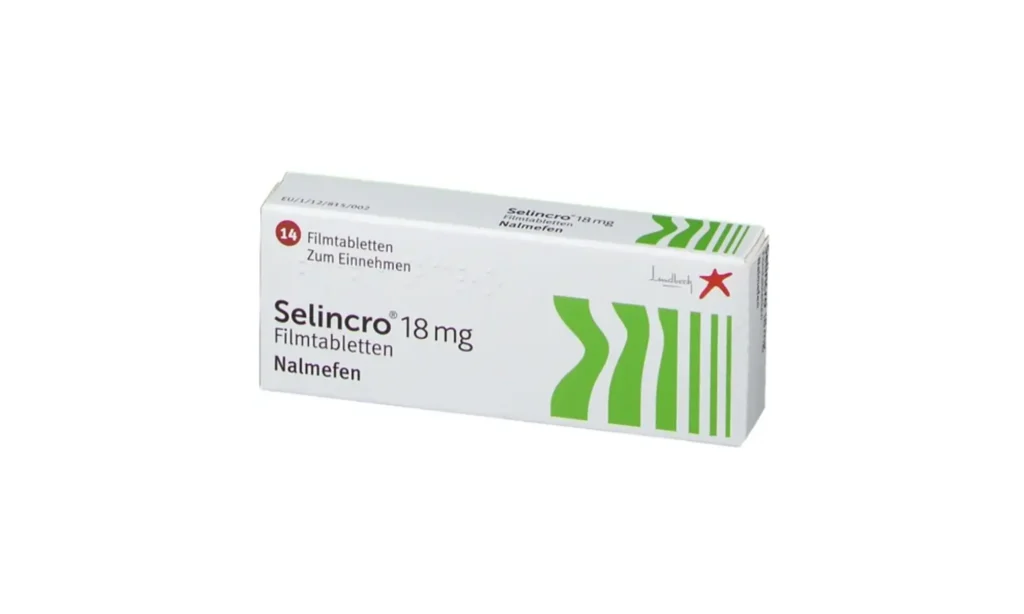
Quelles alternatives à Selincro existent aujourd’hui ?
Passons maintenant aux options disponibles pour remplacer Selincro, selon la stratégie thérapeutique du patient.
L’acamprosate (Aotal)
Spécialité bien connue, l’acamprosate, indiquée pour maintenir l’abstinence après sevrage, constitue une alternative de choix. Bien que différent d’un traitement « à la demande », il soutient la prévention de la rechute après arrêt total de l’alcool.
Le disulfirame (Esperal)
Le disulfirame agit en provoquant des effets désagréables en cas de nouvelles consommations. Il est utilisé en cas d’abstinence mais demande une motivation forte du patient et une surveillance médicale fréquente.
La naltrexone
La naltrexone, molécule proche du nalméfène, présente un mécanisme similaire, avec indication pour réduire les envies d’alcool en cas de consommation à risque. Elle peut convenir chez certains patients, mais son usage est soumis à avis médical spécialisé.
Approche non médicamenteuse
La prise en charge psychosociale (thérapie cognitivo‑comportementale, groupes de soutien comme Alcooliques Anonymes) reste indispensable. Le traitement médical ne suffit jamais seul, il doit être intégré à un accompagnement global.
Lisez aussi : Pourquoi Dissolvurol a été retiré du marché ?
Selincro n’est plus disponible : quelles sont les raisons ?
Le retrait de Selincro du marché répond à une revue critique de son rapport bénéfice/risque et de son usage réel trop souvent hors cadre, sans indication claire de danger sanitaire immédiat. Ce retrait relever davantage d’une décision fondée sur la preuve clinique limitée et le faible apport comparatif, que d’une problématique de sécurité.
Les patients peuvent se tourner vers des solutions alternatives reconnues telles que l’acamprosate, la naltrexone ou le disulfirame, en les associant à un suivi psychosocial adapté. Pour ceux concernés, il est essentiel de consulter rapidement un médecin ou un addictologue afin d’assurer une transition sécurisée et personnalisée.
Cette situation souligne l’importance du bon usage des médicaments, du respect des indications autorisées, et du rôle crucial du suivi médical. Pour garantir un appui efficace dans la lutte contre l’alcoolodépendance, la recherche et l’innovation doivent continuer d’apporter des solutions mieux tolérées et plus efficaces.






